|
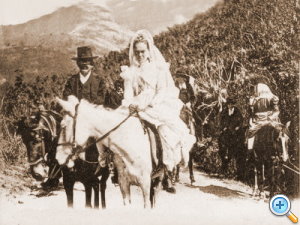 Le mariage dans l'Île de Corse est
souvent l'occasion d'une paix que ni la rigueur de la
justice humaine, ni la douceur et la persuasion de la
loi divine n'auraient pu apporter dans les familles
vivant depuis longtemps dans une inimitié mortelle. Un
jeune homme et une jeune fille appartenant
à des familles ennemies, épris d'amour l'un pour
l'autre, ont pu bien des fois faire fléchir la haine
implacable et le vain orgueil d'un honneur outragé. Le mariage dans l'Île de Corse est
souvent l'occasion d'une paix que ni la rigueur de la
justice humaine, ni la douceur et la persuasion de la
loi divine n'auraient pu apporter dans les familles
vivant depuis longtemps dans une inimitié mortelle. Un
jeune homme et une jeune fille appartenant
à des familles ennemies, épris d'amour l'un pour
l'autre, ont pu bien des fois faire fléchir la haine
implacable et le vain orgueil d'un honneur outragé.
Dans l'intérieur de l'île,
surtout, la parenté constitue une partie de la dot.
Lorsqu'on demande : "Quelle dot apportera telle jeune
fille fiancée à son mari ?" on vous répondra : "Elle est
pauvre, mais elle compte douze ou quinze cousins
germains dans sa race". Cette parenté est un grand titre
pour la demoiselle. Lorsque les parents d'une jeune
fille donnent leur adhésion à la demande d'un jeune
homme, leur parole est sacrée, et ce dernier est admis
dans la maison comme un membre de la même famille. Mais
malheur à lui si la sienne ne l'est pas ; ou si, séduit
par des suggestions perfides, il cherche insidieusement
les moyens de déplaire à sa fiancée et à ses parente
afin de rompre avec eux !
Si la jeune fille trompée et
abandonnée n'a ni père ni frères, ce seront les cousins
qui se chargeront de la vendetta; et à défaut des
parente, ce sera elle-même qui plongera le poignard dans
le sein de son amant déloyal et infidèle.
D'autres jeunes filles, soit par
défaut de courage ou soit pour ne pas en venir à
l'assassinat, quittent, une fois séduites, le toit
paternel, maudites par leurs parente et en horreur à
toutes leurs amies et compagnes, et vont chercher au
loin un état de servage souvent bien rude, pour celles
surtout qui ont vécu jusqu'alors dans un état d'aisance
et d'indépendance.
 Traditionnellement, le mariage
était avant tout une affaire de famille et l'endogamie
était souvent la règle, sauf pour les plus riches. Les règles
sévères de l'église contre les mariages consanguins rencontraient
une résistance permanente chez les Corses et l'union illégale entre
cousins germains constituait l'offense la plus courante constatée
par les prêtres au cours de leurs visites pastorales au XVIIIème
siècle. Traditionnellement, le mariage
était avant tout une affaire de famille et l'endogamie
était souvent la règle, sauf pour les plus riches. Les règles
sévères de l'église contre les mariages consanguins rencontraient
une résistance permanente chez les Corses et l'union illégale entre
cousins germains constituait l'offense la plus courante constatée
par les prêtres au cours de leurs visites pastorales au XVIIIème
siècle.
Les mariages à l'extérieur étaient rares et
faisaient souvent l'objet de sanctions. Dans 80 à 90 pour cent
des cas, les parents
choisissaient pour leur enfant le promis ou la promise
dans le même village, ou dans la même région..
Ces arrangements se faisaient en fonction de certains
critères dictés par des intérêts économiques,
idéologiques ou politiques. Dans les villages, deux
familles ayant des intérêts communs "arrangeaient" u
matrimoniu (le mariage) sans se soucier de la
consanguinité qui pouvait parfois exister entre les futurs époux.
Mais, il y avait aussi des jeunes
gens qui choisissaient de s'unir malgré l'opposition de
leurs parents et qui "forçaient" le mariage. Pour cela,
le garçon n'avait pas d'autre solution que de simuler,
avec son consentement l'enlèvement de la jeune fille. Quelques jours après cette
scapaticcia (fugue), le couple revenait au
village obligeant ainsi les familles à considérer leur
union comme un fait accompli.
Mais, si par malheur, la
jeune fille revenait seule au village parce que son
union n'avait pas marché, elles s'exposaient à subir le
plus grave outrage qu'on puisse infliger, selon les
moeurs de nos ancêtres, à une femme qui a déshonoré sa
famille. Elle devait vivre désormais en recluse
portant sur elle la terrible honte de sa faute. Aussitôt
la jeunesse se réunissait, et il s'y joignait souvent
des parente de la femme condamnée à subir le redoutable
châtiment. La malheureuse était entraînée de force sur la place
publique, et, quoique tout en pleurs et souvent
évanouie, on la plaçait à califourchon et à la renverse
sur un âne ; et après l'avoir promenée ainsi dans tout le
village sous la huée, les sifflets de la foule et au
bruit de la conque marine, on
l'emmenait hors de la commune et après mille
imprécations, on l'abandonnait ainsi
à sa destinée.
Parfois aussi, lorsque les parents
s'opposaient au mariage, les jeunes gens, accompagnés de
deux témoins, se rendaient à la messe du dimanche et à
l'élévation de l'hostie les jeunes gens, chacun à leur
tour, devant l'assemblée des fidèles, déclaraient vouloir se prendre mutuellement pour
époux puis quittaient précipitamment l'église. C'est ce
qu'on appelait u matrimoniu di a volpe
(le mariage du renard) ou matrimoniu alla greca
(mariage à la Grecque). Tout le village étant désormais au courant de leur
intention, il ne restait plus pour les parents qu'à
entreprendre des négociations pour fixer la date du
mariage.
Un proverbe Corse dit ceci: "Maries-toi
dans ton pays, maries-toi dans ta commune et si tu le
peux maries-toi dans ton village". Il y avait deux sorte de mariages:
le mariage "proche" (parfois même consanguin en raison
d'une vie paysanne en autarcie) célébré selon le rite du
ruban et de la quenouille, et le mariage "lointain".
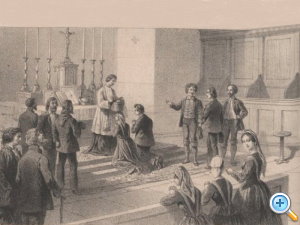 Dans le premier cas, les jeunes
gens sont accompagnés à la mairie et à l'église. Dans le premier cas, les jeunes
gens sont accompagnés à la mairie et à l'église.
Avant la bénédiction, le curé
faisait placer un seau de bois (secchia)
sur la tête de la future mariée. C'est dans cette
position de porteuse d'eau qu'elle l'écoutait lui
rappeler les devoirs du mariage, après quoi, le curé lui
enlevait le seau et faisait son second discours au
fiancé.
C'est
uniquement le jeune homme qui passe au doigt de la jeune
fille l'alliance que vient de lui remettre le curé
et qui est utilisée pour tous les mariages (signe de
l'extrême pauvreté qui existait en Corse à cette
époque). Elle la gardera
24 heures puis la lui ramènera.
Après la cérémonie, tout le monde
-sauf les mariés qui ont droit au carrosse- remonte sur
son cheval, sa mule ou son âne.
Dans certains villages, quand la
mariée, suivie de ses parente et de ses amis, se rend au
pays de son mari, elle fait une halte à la première
fontaine ou ruisseau qui se trouve sur son passage. Elle
s'agenouille, fait le signe de la croix, et prenant de
l'eau dans ses mains, elle élève vers Dieu une prière
suppliante et douce : "Seigneur, ordonnes que cette eau
me purifie et emporte avec elle mes défauts à la mer,
afin que je puisse entrer dans la maison de mon mari
sans tache comme je suis sortie du sein maternel". Elle se
signe de nouveau, se lève et continue sa route avec son
cortège jusqu'au toit conjugal.
Dans certaines régions la mère, ou
à défaut de la mère, la plus proche parente se tient
debout sur le seuil de la porte; et quand la mariée
arrive, elle lui offre la quenouille et le fuselu ornés
de rubans en symbole d'alliance. Après une tendre
accolade et de gracieuses paroles, elle la conduit dans
le "salottu"où toute l'assemblée la suit
et embrasse le nouveau couple.
Dans certains villages, la femme qui est chargée de
faire accueil à la mariée lui tend l'extrémité d'un long
ruban dont elle garde l'autre extrémité
dans la main et la précède ainsi dans la chambre
commune.
Dans d'autres lieux encore, on apporte aux époux une
cuiller remplie de miel ou de lait caillé, et ensuite,
tout le cortège s'empresse de goûter le miel ou le lait
qui sont le symbole du jour de la douceur.
Enfin il est des pays où l'usage n'a introduit aucune
cérémonie pour le retour au logis conjugal ; mais la
compagnie toute entière embrasse les époux et leur
adresse des souhaits de prospérité.
Dans le mariage lointain, l'un des
futurs époux est issu d'un autre village ou d'une autre piève. Un carozzu (carrosse) vient prendre
la mariée pour l'emmener au village de son futur époux
qui l'attend sur le chemin avec une branche d'olivier.
Pendant le trajet, on lance sur le cortège des poignées
de riz, de fleurs et de grains de blé. Conduite à sa
nouvelle demeure sous le bruit des fusillades, l'épouse
est reçue par son beau père qui l'embrasse et lui remet
la clé de la maison ainsi que toutes les clés des
armoires puis l'invite à entrer.
 La demande en mariage, dans une
société Corse inhibée par la pudeur et la honte, se
faisait sous forme de jeu. Pour faire sa déclaration, le
jeune homme se débrouillait pour rencontrer l'élue tout à
fait par hasard, quand elle allait chercher de l'eau à
la fontaine, ou quand elle se rendait à la rivière pour
faire le bucatu (lessive). Alors, il
s'approchait d'elle et lui parlait sur le ton de la
plaisanterie en laissant deviner ses intentions. Si la
jeune fille lui répondait de la même manière, cela
voulait dire qu'elle acceptait ses avances. Si, elle rejetait sa demande, elle
le regardait fièrement, lui montrait son coude puis lui
tournait le dos en prononçant des mots blessants. Pour
éviter ce genre de déconvenue, c'était souvent le père
du jeune homme où de la jeune fille qui se présentait au
domicile des parents pour faire une demande dans les
règles. La demande en mariage, dans une
société Corse inhibée par la pudeur et la honte, se
faisait sous forme de jeu. Pour faire sa déclaration, le
jeune homme se débrouillait pour rencontrer l'élue tout à
fait par hasard, quand elle allait chercher de l'eau à
la fontaine, ou quand elle se rendait à la rivière pour
faire le bucatu (lessive). Alors, il
s'approchait d'elle et lui parlait sur le ton de la
plaisanterie en laissant deviner ses intentions. Si la
jeune fille lui répondait de la même manière, cela
voulait dire qu'elle acceptait ses avances. Si, elle rejetait sa demande, elle
le regardait fièrement, lui montrait son coude puis lui
tournait le dos en prononçant des mots blessants. Pour
éviter ce genre de déconvenue, c'était souvent le père
du jeune homme où de la jeune fille qui se présentait au
domicile des parents pour faire une demande dans les
règles.
Selon la coutume, on pouvait
considérer que deux jeunes gens étaient mariés et
pouvaient vivre ensembles quand ils s'étaient donné l'abracciu
(quand ils s'étaient embrassés). Après avoir convenu de
la dot, les familles se donnaient l'accolade, tiraient
des coups de feu et mangeaient des beignets. Le caractère officiel de cette
union (le mariage civil et religieux pouvait n'être
célébré que bien plus tard), même s'il n'était pas légal,
était sacré par la
parole donnée. Rompre l'abracciu, s'était s'exposer à une
terrible vendetta.
Si le fiancé meurt avant le
mariage, celui-ci peut quand même être célébré longtemps après
les funérailles
et la
fiancée doit porter le deuil pendant une année sans
jamais sortir de la maison. Si, après le mariage, la femme
commet l'adultère, elle peut habiter avec un autre
homme. Son époux n'engagera pas de vendetta car il
considère que son épouse s'est déshonorée seule et n'est
pas digne qu'un homme d'honneur expose sa vie pour
elle. |